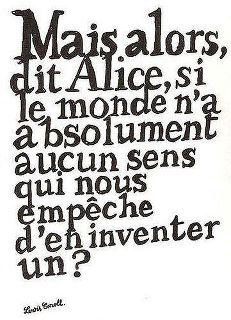MARGUERITE YOURCENAR- L´OEUVRE AU NOIR
par Federica Ramazzi et Adriana La Buonora
“Toute douleur prolongée insulte à leur oubli.”
Marguerite Yourcenar “ Mémoires d'Hadrien.
Marguerite Yourcenar “ Mémoires d'Hadrien.
Marguerite
Cleenewerck de Crayencour, dont elle utilise l’anagramme est une écrivaine
francophone, mais non française.
Elle
est née à Bruxelles, le 8 juin 1903. Le décès de sa mère lors de
l'accouchement, a fait qu'elle ait toujours souffert malgré les efforts de son
père qui était un homme très cultivé, anticonformiste et très grand voyageur.
Il
a tenait énormément à l'éducation de Marguerite et l’envoya toujours dans des
institutions privées. Son premier poème dialogué, Le Jardin des
chimères, est publié à compte d'auteur en 1921 et signé Yourcenar,
anagramme de Crayencour à l'omission d'un C près, qui deviendra son patronyme
légal en 1947 lors de sa naturalisation comme américaine.
Son roman Mémoires d'Hadrien, en 1951, connaît un succès mondial et
lui vaut le statut définitif d'écrivain, consacré en1970 par son élection à l'Académie royale de langue et de
littérature françaises de Belgique, et dix ans
plus tard, par son entrée à l'Académie française, grâce au soutien actif de
l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson.
M. Yourcenar est la première femme à siéger à l'Académie française. Elle
dit avoir longtemps hésité, pour le choix de son sujet, entre l'empereur Hadrien et
le mathématicien-philosophe Omar Khayyâm.
Elle
a écrit des anagrammes, des poèmes dialogués, des
essais, des critiques et des romans. Elle a aussi étudié des
langues anciennes, la littérature et fait de nombreuses traductions.
Elle
a été définie comme humaniste. L'obscurantisme et l'ignorance sont des soucis toujours
présents dans l'œuvre de cette femme.
C’est
peut-être pour ça que le personnage de Zénon paraît si naturel. Sa lutte contre
le cléricalisme, l'obscurantisme, l'intolérance de ce Dieu vengeur et punisseur
qui brûle tout ce qui ne comprend pas est de chaque instant.
Zénon
représente l'antagonisme entre Moyen Âge et Renaissance, du choix de l'individu
de mourir de sa propre main contre la possibilité d'une exécution honteuse; il
refuse d'obéir à son époque.
Comme
extrême geste de rébellion, comme ultime signe d’insoumission, Zénon préfère se
suicider en se coupant les veines avant que de se faire brûler le lendemain.
L’extrait
montre une lutte tenace contre son propre corps. La mort apparaît inéluctable
car même en agonie « son corps (avait) une activité violente et
désordonnée”, il avait soif mais il était incapable de l'étancher, son pied lui
pesait, il ne réussissait pas à se déboutonner, la nausée apparaît... ».
Lorsque la mort
naturelle ou accidentelle approche, en général, on ne la sent pas venir mais
lorsque le suicide est décidé et la personne passe à l’acte, toust son corps et son âme sont en émois. Tout se bouscule
à l’intérieur, le cœur bat plus vite donc le sang circule à grande
vitesse ; c’est l’excitation d’avoir pris une décision vitale et de savoir
que c’est la bonne. C’est aussi savoir que l’heure de la délivrance approche et
dans le cas de Zénon c’est aussi le fait de savoir qu’il va prendre sa revanche
sur sa vie et sur son destin : c’est lui qui choisit quand et comment mourir.
De plus, Zénon ne va pas mourir comme ses bourreaux l’ont voulu : il leur
rit au nez, c’est lui qui a gagné.
Zénon
calcule plusieurs fois la durée de sa
souffrance. « Trois quarts d'heure qui s'étaient écoulés » et « il essaya de calculer le temps qu'il
faudrait pour que la flaque rouge
s’allongeât de l'autre côté du seuil ». Cependant il conçoit le futur
« cette soif cesserait bientôt », « Mais peu importait, il était
sauvé », « on ne brûlerait demain qu'un cadavre ».
Le temps qui passe
est lent, en contradiction avec les sensations vertigineuses et rapides que
ressent Zénon internement et sa soif intense de délivrance.
La rapide
description des éléments extérieurs représente la mort dans son sens le plus
large. « …les bruits de clochers …» : lors d’un enterrement le
clocher d’une église retentit et les cloches se font entendre. « …le
tonnerre… », c’est encore une image d’un temps triste, noir, obscur et
gris comme le moment historique que vit Zénon. Mais c’est aussi l’image de la
mort : on n’associe que très rarement le soleil et le beau temps à ce
moment terminal de la vie, surtout si la personne se suicide. Le tonnerre nous
indique la tempête et lorsque Zénon se suicide tout son corps et son âme sont
en pleine « tempête ». Marguerite Yourcenar parle de « … criards
oiseaux regagnant leur nid … », les oiseaux peuvent être assimilés
aux corbeaux qui sont les oiseaux qui représentent la mort. Ces derniers
crient toujours lorsque la mort rode dans les environs. Dans le cas de Zénon la
mort est non seulement présente mais aussi consciente, vivante, choisi,
désirée, voulue et accomplie. Finalement, Zénon entend « au dehors le son
précis d’un égouttement... le sang qui s’écoulait sur le carreau.» :
le suicide par coupure des veines est une mort lente qui voit le peu de temps
qui reste, passer. Chaque goutte sur le carrelage est une de moins avant la
mort certaine. Le temps passe, chaque goutte
peut s’assimiler aux secondes qui passent et qui sont les dernières de
souffrance avant la libération finale.
Toute cette
description des éléments extérieurs renforce l’idée de souffrance de l’âme et
du corps et la soif intense de délivrance.
On
peut trouver une expression-clé “Mais peu importait: il était sauvé”. Le triomphe du suicide c'est l'ironie de sa
propre mort. A celle-ci, on ajoute que Zénon choisit sa façon de mourir. Le feu, parmi les ressources
de l'inquisition (dont l'eau, la corde, et plusieurs éléments de torture)
utilisé contre tout suspect d'hérésie ou apostasie, non seulement cherche la
purification, mais la déshumanisation de l'être. C'est contre ça la révolte de
Zénon. Il est sauvé de l'anonymat, de l’oubli, des cendres, du rien.
MARGUERITE DURAS- L´AMANT
par Lucía González et Claudio Silva
MARGUERITE DURAS- L´AMANT
par Lucía González et Claudio Silva
MARGUERITE DURAS
Marguerite Duras, de son vrai nom Marguerite Donnadieu, est née le 4 avril 1914
à Gia Dinh, Saïgon. Elle passe toute son enfance au Vietnam à 1932 après avoir
obtenu son baccalauréat, elle quitte Saïgon et vient s’installer en France pour
poursuivre ses études. En 1963 elle obtient sa licence en Droit.
Elle
était partisanne du Parti Comuniste Français et en 1950 elle le quitte.
Journaliste dramaturge scénariste, elle reçoit le Grand
prix du théâtre de l'Académie française en 1983 et le prix
Goncourt en 1984 pour « L' Amant », adapté par Jean-Jacques
Annaud au cinéma. Son œuvre est à rattacher au courant du
Nouveau Roman. Les textes de Marguerite Duras, concis, chargés d'ellipses et de
silences, se disloquent jusqu'à l'énigme. Les écrits, les paroles sont à
la fois insuffisants et superflus. Parmi ses romans, on peut citer « Un
barrage contre le Pacifique » (1950), « Le Marin de Gibraltar »
(1952), « Moderato cantabile » (1958).
Elle
connaît une notoriété internationale avec Hiroshima mon amour, le
film d’Alain Resnais dont elle écrit le scénario et les dialogues.
L’amant
L’amant
est un roman de Margueritte Duras, qui date de 1944 et présente l’histoire probablement
autobiographique d’une jeune fille d’origine européenne âgée de quinze ans qui
tombe amoureuse d’un chinois fort riche qui redouble son âge.
Bien
que le roman porte sur cette histoire d’amour, il y a une
multiplicité d’interprétations et de niveaux de lecture. Il s’agit aussi d’une
description implicite de la situation de
conflit social et ethnique, de la différence d’âge, de la découverte de l’amour
et du plaisir dans le cadre de la première expérience sexuelle.
Elle
récrée la souffrance éprouvée au sein de sa propre vie familiale, la
relation avec ses frères, l’amour envers sa mère.
Même
si on peut « entendre » le tonne autobiographique du roman, il
ne faut pas l’assimiler à un récit spécifique des évènements da sa
vie. En effet on aperçoit la réalité nuancée par son imagination.
La
narratrice évoque plusieurs évènements, quelques-uns
de forme complète complets, d’autres inachevés et même d’autres qu’elle
raconte plusieurs fois pour préciser certains aspects de ce qui est présent ou
pour le montrer d’un point de vue différent.
Encadrée
dans un environnement exotique cette histoire s’inscrit dans l’Indochine
coloniale de l’entre guerre.
PRÉSENTATION
DE L’EXTRAIT.
Cet
extrait présente une scène intime entre le personnage principal- la jeune fille
de quinze ans- et son aimé.
La
scène se déroule dans une chambre, plus
précisément dans le lit « il met sa tête sur moi et il pleure de me voir
pleurer » où la fille pleure à cause de ses sentiments face a sa mère.
Le
récit commence à la première personne et passe à la troisième personne quand elle fait référence aux rêves.
Elle exprime ses propres sentiments par
rapport aux sentiments et expériences
vécues par sa mère, à tel point qu’il en existe une identification.
« A
travers les persiennes le soir est arrivé » à partir de ce moment le
narrateur focalise son attention sur le décor, l’introduction des éléments du
monde extérieur dans la scène : le vacarme, les lampadaires rompent
l’atmosphère intime du premier moment et donnent lieu à la réflexion. En même
temps qu’ils s’habillent, ils s’aperçoivent des changements chez la
jeune fille qui « a vieilli », « qui est fatiguée ».
À la
fin du récit la description de la cohue établi une opposition entre l’intimité
des amants et l’aliénation de la foule qui marche sans sens sans un sens,
sans désirs et qui semble être
accompagnée mais que finalement ils sont isolés.
ANALYSE
DE L’EXTRAIT
La
narration commence avec l’expression d’une douleur qui est
« consolée » par les baisers. On pourrait penser que la souffrance sert
de décor pour cette histoire parce que la jeune fille trouve une ambiance aisée
pour se détendre et pour partager la douleur avec son amant. Alors, elle trouve
dans « cette chambre » un espace introuvable dans sa famille.
Le marqueur temporel « ce-jour-là »
place les évènements qui suivent dans un passé par rapport au présent de la
narration. L’effet de ses larmes dépasse
le jour auquel la narratrice fait référence pour consoler aussi la douleur du
temps passé et du futur par rapport à ce passé, qui est, bref, le présent de la
narratrice.
« lui
dit que… »le recours au discours rapporté sert à récréer le dialogue entre
les personnages, cette récréation nous permet de connaître la pensée de la
narratrice qui exprime son désir de quitter sa mère.
« Je
pleure, il met sa tête sur moi », afin de nous rapprocher aux évènements
passés dans la chambre, la narratrice emploie le présent historique.
Ce
passage nous montre le degré d’intimité et d’empathie existant entre le deux amants
toujours du point de vue de la narratrice-personnage.
« Le
malheur de ma mère a occupé le lieu du rêve » on peut remarquer la
présence du malheur de la mère dans les rêves de la fille. C’est à travers le
rêve que la fille trouve un moyen d’expression, qui est l’expression des
sentiments de sa mère qui deviennent aussi les siens. La douleur remplaçant les
illusions de l’enfance « jamais les arbres de Noël », c’est l’image
d’une femme seule dans le désert mettant en relief les sentiments de solitude,
car elle ne parle avec personne.
« À
travers les persiennes le soir est arrivé », une série d’énnoncés où les
verbes conjugués sont au passé composé et aident à construire un changement d’atmosphère
qu’introduit une description sensorielle du monde extérieur qui rompt avec
l’intimité de la scène prècedent.
Nous
passons d’une profonde intimité entre les personnages, d’une identification qui
leur permet de partager les sentiments, à l’irruption du bruit de l’extérieur,
de la lumière qui s’allume pour briser
l’ambiance presque sacrée des amants dans le lit.
« Nous
sommes sortis de la garçonnière », à travers cette métaphore s’illustre la
transition entre deux états d’esprit. D’une part l’état de communion entre les
amants qui les fait ressembler à deux enfants, et d'autre part deux personnes habillées selon
les conventions sociales.
Finalement
la fille se reconnaît comme une femme
quand elle pronnonce :
«
J’ai vieilli». Son amant la reconnait de cette façon aussi, en disant
« tu es fatiguée ».
Le
dernièr paragraphe décrit le dégre d’aliénation que souffre « la
foule de la Chine » qui marche « galeuse comme les chiens abandonnés ».
Le point de vue de la narratrice par rapport à la façon de vivre nous montre un
regard distant, qui exprime le dégoût par ces gens qui marchent ensemble comme
s’ils n’ avaient pas de sentiments « sans tristesse, sans curiosité ».
Le paragraphe finit avec une préoccupation existentialiste de part de la
narratrice qui voit la cohue symbolisant l’humanité dans sa marche sans propos.
Pour conclure, cet extrait porte sur la
profonde expression de douleur qui s’exprime à travers les pleurs partagés des amants
unis par ce sentiment.
Le
proposé de la narratrice qui regarde avec dégoût l’aliénation de la société chinoise
et par extension du monde capitaliste.
L’extrait
montre le style personnel de l’écriture de Duras dans ce roman et sa capacité pour élever à un
plan universel les sentiments et les préoccupations de cette fille qui se
plaint de la pauvreté, de la solitude et de la faim.
Merci Mme le Professeur Soledad Lessa (corrections)!!!!